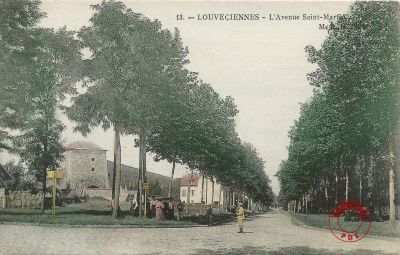Histoire de Louveciennes
Les premiers éléments historiques connus concernant Louveciennes datent de l’époque gallo-romaine. II est cependant à peu près établi maintenant que le lieu était habité bien avant cette époque.
Nous pouvons dire que Louveciennes a bénéficié de la civilisation celtique et l’église actuelle, à la position si caractéristique, a pu prendre la suite d’un lieu de culte beaucoup plus ancien.
L’origine du nom de Louveciennes est elle-même sujette à conjectures. D’aucuns le font venir de Mons Lupicinus, Mont des Loups, d’autres d’un domaine d’un hypothétique Lupicinus. Ce Mons Lupicinus, repris par des scribes religieux et les moines copistes, est moins probable, contrairement à Marly qui viendrait de Marleuim Regis et Croissy de Cruciacum.
Il existe en tous cas un document authentique, une Charte de 862 par laquelle le roi Charles le Chauve entérine un accord entre la communauté religieuse de Saint-Denis, dont dépendait alors la paroisse, et leur abbé Louis, concernant les conditions matérielles de la vie des religieux vivant dans le moutier de l’époque qui s’étendait sur la quasi-totalité de l’actuelle place de l’Eglise.
Au début du XIIIe siècle, le nom du village s’orthographie « Lovecienes ». Jusqu’au XIXe siècle, la plus grande fantaisie règne dans la transcription des noms, même des noms propres.
Le village vécut pendant longtemps de la culture du sol, et surtout de celle de la vigne. Au Xe siècle, le vin du pays est servi à la table royale. II servira au coupage des vins de Champagne pendant de nombreuses générations. Quelques noms nous rappellent encore ce passé : chemin (rue) du Pressoir, rue des Barillets.
A la fin du XIe siècle, début du XIIe, apparaissent dans les chroniques locales, les noms de Guillaume, seigneur du Pont, Gasce de Maubuisson, Jean de Louveciennes. Seul le château du Pont a gardé un air d’authenticité, n’ayant été que peu remanié. Le château de Maubuisson et sa tour carrée ont disparu, le château seigneurial proche de l’église a laissé place au château du Parc.
C’est aussi à cette époque que Suger (1081-1151), abbé de Saint-Denis, l’un des hommes les plus savants de son époque s’il faut en croire les chroniques, entreprend la construction de l’église dont le chevet (façade Est) et la partie du chœur sous le clocher nous sont seuls parvenus pratiquement intacts. Un grand nombre d’éléments de construction ou de décoration sont typiques de l’époque.
Dans l’ancien temps, l’édifice était entouré du cimetière sur trois côtés. L’église est placée sous le vocable de Saint-Martin et Saint-Blaise. Saint-Martin parce que, si l’on en croit la légende, c’est tout près d’ici qu’aurait eu lieu, un triste jour de novembre, le partage du fameux manteau au bénéfice d’un mendiant qui n’était autre que le fils de Dieu. Mais elle est aussi placée sous le vocable de Saint-Blaise, attestant ainsi ses origines celtiques, à tel point que jusqu’à la Révolution de 1789, au début de février, un grand pèlerinage déroulait ses théories de fidèles autour de l’édifice.
II faut attendre le XVIIe siècle pour voir le village prendre de l’importance. Louis XIV ayant choisi de faire de Marly un havre de paix et de repos, pour oublier Versailles, ses contraintes et son étiquette, Louveciennes va se trouver entrainée dans le sillage de sa voisine.
En 1681 commence l’édification de l’Aqueduc, Louvois lui-même dirige les travaux. De nombreux ouvriers s’affairent à la construction. Au bout de 3 ans, les trente-six arches dominent l’horizon sur 643 mètres.
1681 voit également le début de la construction de la Machine de Marly, sous la direction deux Liégeois : le chevalier Arnold de Ville (1653 – 1722) et le maitre charpentier Rennequin Sualem. Puis, c’est la pose des conduites, des réservoirs relais, des renvois de machinerie. En 1682, le Roi-Soleil achète à Pierre de Soppite, seigneur de Louveciennes, le domaine de la Haute-Barre et y fait construire une briqueterie-tuilerie qui fournira les éléments en céramique pour les pavillons de Marly.
Le nombre de Louveciennois occupés à ces travaux, augmente sans cesse et la quasi-totalité de la population travaille à ces ouvrages.
La topographie des lieux change, les déblais extraits du vallon de Marly sont déversés sur le territoire de Louveciennes par des soldats. Le relief de la colline est modifié. Le « Chemin des Glaises » nous en conserve le souvenir.
Le camp des Gardes-Suisses est créé au-delà du Bois Brûlé (Chemin des Gressets à l’emplacement actuel des vergers et des jardins familiaux)
Louis Oger de Cavoye (1640 – 1716) Grand Maréchal des Logis de la maison du roi, habita au château de Voisins.
Louveciennes grandit toujours. Nous sommes maintenant au XVIIIe siècle, époque des plaisirs, des grandes réceptions. Les nobles et les Grands de la Cour trouvent à Louveciennes des séjours enchanteurs.
C’est la comtesse de Toulouse, ce sont Mesdames de Mailly, de Vintimille, de Châteauroux, Louis Elizabeth de Boubon-Condé (Princesse de Conti 1696 – 1775) mais ce sera surtout la comtesse du Barry, favorite de Louis XV pour qui il fait construire par son architecte, Nicolas Ledoux, le pavillon de musique situé à l’extrémité du chemin de la Machine et dont la décoration est confiée à Boucher et Fragonard. Madame du Barry est adorée par les gens du village pour lesquels elle est d’une grande bonté.
C’est l’époque où Madame Elisabeth Vigée-Lebrun (1755 – 1842), qui demeure au « château des Sources », immortalise sur ses toiles les traits de la comtesse. C’est l’époque ou André Chénier (1762 – 1794) courtise la châtelaine de Voisins, Francoise-Charlotte le Coulteux de la Noraye.
Mais la révolution n’épargne pas Louveciennes. Madame Du Barry (1743 – 1793) est arrêtée le 22 septembre 1793 par un Anglais dénommé Greive qui a établi son quartier général dans une auberge de Voisins. Madame du Barry sera guillotinée le 8 décembre 1793. André Chénier connaitra le même sort le 25 juillet 1794 alors que le surlendemain la chute de Robespierre marquait la fin de la Terreur…
Louveciennes mettra très longtemps à se relever de la Révolution. Les gens fortunés ont fui ou ont péri dans la tourmente. La misère s’installe dans le pays où le nombre d’habitants baisse. Les ouvriers spécialisés occupés à la Machine et les gens de maison quittent le village.
Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir Leconte de Lisle (1818 – 1894) et Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864) au château de Voisins, Guy de Maupassant au château de Bellevue. Madame Aubernon (Lydie Lemercier de Nerville dite Madame Aubernon 1825 – 1899) organise des salons littéraires au Cœur-Volant. Elle y accueillera Marcel Proust, Alexandre Dumas, Arvède Barine, Anatole France, … Voir aussi les peintres impressionnistes Alfred Sisley, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Jeanne Baudot, Berthe Morisot, le grand sculpteur Emmanuel Frémiet dont la maman revit en médaillon sur la sépulture de famille, au cimetière sous les Arches.
Bernard Pierre Magnan (1791 – 1865), Maréchal de France, résida au château de Louveciennes de 1852 à 1865. Camille Saint-Saëns (1835-1921), compositeur, vécut à Voisins de 1865 à 1870. Lucile Doux (1821-1896), artiste peintre, mourut à Louveciennes.
Pendant la guerre de 1870, les Prussiens installent leurs troupes en garnison au 22 Route de Versailles, dans la maison de Camille Pissarro qui s’est réfugié en Angleterre. En 1870, l’Aqueduc sert d’observatoire à Bismarck qui surveille à la longue vue l’issue des combats de Buzenval et de Rocquencourt.
Le 1er avril 1885 est une date importante pour le village : pour la première fois le chemin de fer de Paris à Marly s’arrête en gare de Louveciennes. Plus besoin de prendre la diligence jusqu’à Chatou où l’on retrouvait le train de Saint-Germain. L’avènement du chemin de fer va apporter de nombreux changements pour la commune avec l’apparition de résidences secondaires bourgeoises de petits manoirs et « campagnes ».
Le milieu du XIXe siècle marque le début de l’exploitation du calcaire grossier sur le territoire de la commune. Ces carrières seront exploitées une quarantaine d’années puis seront transformées en champignonnières jusqu’en 1935.
De nombreuses personnalités historiques tomberont sous le charme de Louveciennes au XIXe siècle et tout au long du XXe. Ainsi, le Maréchal Joffre (1852 – 1931) y achète une châtaigneraie pour y faire construire sa demeure au début des années 1920. Il y habita jusqu’à sa mort le 3 janvier 1931 et y repose avec sa femme Henriette dans son mausolée qui se trouve dans la propriété.
Printemps 1931, le préfet de Seine-et-Oise pose la première pierre du groupe scolaire Paul Doumer, inauguré le 20 octobre 1932.
A partir des années 60, Louveciennes se transforme avec des projets immobiliers majeurs comme la construction de la résidence du Parc du Château (à partir de la fin des années 50) et de la résidence Dauphine en 1965 ~ 67. Suivra la résidence des Clos dans les années 70 puis les bureaux de la Princesse.
Le groupe scolaire Leclerc a été construit en 1960 sur une partie de la propriété du Château de Louveciennes.
Un gymnase sera construit rue Paul Doumer en 1970, puis agrandi en 1974. Il porte le nom de Jacques Tassin ancien maire de Louveciennes.
Plus récemment, un nouveau projet immobilier voit le jour aux Plains Champs (2014) sur la zone de l’ancien stade du même nom.
Quelques personnages célèbres à Louveciennes au XXe siècle :
- Anaïs-Pauline-Nathalie Aubert dite Mademoiselle Anaïs (1802 – 1871), Actrice Française décédée à Louveciennes
- Leconte de Lisle (1818 – 1894) Poète Français décédé à Louveciennes au Pavillon de Voisins
- Arvède Barine (Louise-Cécile Bouffé dite Arvède Barine 1840 – 1908), historienne et critique littéraire.
- Emmanuel Frémiet (1824 – 1910), sculpteur a habité Louveciennes
- Gabriel Fauré (1845 – 1924), compositeur, habita Louveciennes
- Kurt Weill (1900 – 1950), compositeur de musique qui a notamment composé le ballet « Les Sept péchés capitaux »
- Miguel Louis Pascal de Zamacoïs (1866 – 1955), romancier et poète est né à Louveciennes.
- Charles Münch (1891 – 1968), chef d’orchestre, habita Voisins à partir de 1958.
- Julien Cain (1887 – 1974), directeur de la Bibliothèque nationale, eut à Voisins une propriété devenue aujourd’hui une maison de la culture de la ville qui porte son nom.
- Jean-Paul Palewski (1898 – 1976), homme politique, avocat et député de Seine-et-Oise, habitat la ferme des Deux Portes. C’est à lui que l’on doit le nom du nouveau département des Yvelines en 1964. Auteur d’un livre sur Louveciennes (Louveciennes à travers les Alpes Galantes)
- L’écrivaine américaine Anaïs Nin (1903 – 1977) résidera à Louveciennes au 2 bis rue de Montbuisson de 1931 à 1935.
- Pierre Lazareff (1907 – 1972), journaliste et patron de presse, posséda à Louveciennes avec son épouse Hélène la propriété « La Pelouse », face à la Grille Royale.
- Alain Bernardin (1916 – 1994), fondateur du Crazy Horse, habita rue de Montbuisson.
- Henri d’Orléans (1908 – 1999), Comte de Paris, et son épouse Isabelle d’Orléans-Bragance (1911-2003), Comtesse de Paris, de retour en France en octobre 1953 après l’abrogation de la loi d’exil, emménageront en 1935 dans le manoir du Cœur-Volant avec leurs onze enfants. Ils y recevront de nombreuses personnalités du monde politique jusqu’en 1972, date de la vente de la propriété.
- Nicole Henriot-Schweitzer (1925 – 2001), pianiste française.
- Henri Bauchau (1913 – 2012), poète dramaturge et romancier belge est mort à Louveciennes le 21 septembre 2012.
- Yvette Giraud, (1916 – 2014), chanteuse lyrique, s’est mariée à Louveciennes en 1957. Elle demeura un moment au 4 Quai Conti dans les années 50.
- Michel Rocard (1930 – 2016), Premier ministre, fut député de la Troisième circonscription des Yvelines et résida un temps à Louveciennes.
- Daniel Darieux (1917 – 2017), Actrice, demeura au Cœur Volant
- Georges Prêtre (1924 – 2017), Chef d’orchestre, habita Louveciennes
- Jean Pierre Pernaut (1950 – 2022), Le journaliste résidera à Louveciennes jusqu’en 2022.
- Karl Lagerfeld (1933 – 2019), le grand couturier Allemand avait acquis une propriété qu’il appelait « sa villa en dehors de Paris »
- Brigitte Bardot, (1934 – 2025), comédienne. A grandi à Louveciennes dans l’ex-pavillon norvégien de l’Exposition universelle de 1889 qui se situe au 17 rue du Général Leclerc. Elle s’y est aussi mariée avec Jacques Charrier le 18 juin 1959.
Pour n’en citer que quelques-uns …
Et les personnalités contemporaines.
- Dany Carrel, de son vrai nom Yvonne Suzanne Chazelles, actrice et chanteuse, fréquenta l’orphelinat Saint Joseph de 1934 à 1945
- Jean-Hugues Anglade, comédien.
- Richard Berry, comédien.
- Catherine Lara, chanteuse.
- Thomas Lilti, cinéaste.
- Claude Makélélé, footballeur.
- Nathalie Marquay, Miss France 1987 et épouse du journaliste Jean Pierre Pernaut.
- Agnès Troublé, créatrice de la marque de vêtements Agnès b.
- …